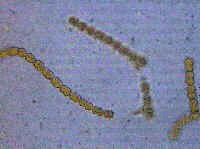![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Elles ne sont qu'une vingtaine mais elles font beaucoup de bruit. On les appelle SNC, des initiales des trois premiers lieux où l'on en a trouvé : Shergotty en inde, Nackhla en Egypte et Chassigny en France. Toutes les météorites SNC ressemblent à l'un ou l'autre de ces trois "modèles", avec une préférence pour les shergottites. Ce sont toutes des pierres volcaniques et ont un âge compris entre 1,3 milliard d'années et 200 millions d'années.
Les Shergottites sont des basaltes, donc composés de feldspath, de pyroxène et de cristaux d'olivine. Ils ont une structure microlitiques (quand on regarde une lame de basalte au microscope, on observe de très fins grain, invisibles à l'oeil nu).
Les Nackhlites sont des roches de la famille du basalte et ont donc, à peu de choses près, la même composition, avec des cristaux plus gros. Ils ont en effet refroidis en profondeur et lentement.
Les Chassignites (ou la Chassignite car il n'en existe pour l'instant qu'une) sont composées de beaucoup plus de cristaux d'olivine que les autres
|
Nom de la météorite |
Lieu de découverte |
Date de la découverte |
Masse (en g) |
Type |
|
Chassigny |
France, Chassigny |
3 octobre 1815 |
4 000 |
dunite (chassignite) |
|
Shergotty |
Inde, Shergahti |
25 août 1865 |
5 000 |
basaltique shergottite |
|
Nakhla |
Egypte, El-Nakhla |
28 juin 1911 |
10 000 |
clinopyroxenite (nakhlite) |
|
Lafayette |
Etats-Unis, Indiana, Lafayette |
1931 |
800 |
clinopyroxenite (nakhlite) |
|
Governador Valadares |
Brésil, Governador Valadares |
1958 |
158 |
clinopyroxenite (nakhlite) |
|
Zagami |
Nigeria, Zagami Rock |
3 octobre 1962 |
18 000 |
basaltique shergottite |
|
ALHA 77005 |
Antarctique, Allan Hills |
29 décembre 1977 |
482 |
péridotite (lherzolitic shergottite) |
|
Yamato 793605 |
Antartique, Yamato Mountains |
1979 |
16 |
péridotite (lherzolitic shergottite) |
|
EETA 79001 |
Antarctique, Elephant Moraine |
13 janvier 1980 |
7 900 |
basaltique hergottite |
|
ALH 84001 |
Antarctique, Allan Hills |
27 décembre 1984 |
1 939,9 |
orthopyroxenite |
|
LEW 88516 |
Antarctique, Lewis Cliff |
22 décembre 1988 |
13,2 |
péridotite (lherzolitic shergottite) |
|
QUE 94201 |
Antarctique, Queen Alexandra Range |
16 décembre 1994 |
12,0 |
basaltic shergottite |
|
Dar al Gani 476 Dar al Gani 489 Dar al Gani 735 Dar al Gani 670 Dar al Gani 876 |
Libye, Sahara |
1 mai 1998 1997 1996-1997 1998-1999 7 mai 1998 |
2 015 2 146 588 1 619 6,2 |
basaltique shergottite |
|
Los Angeles 001 Los Angeles 002 |
United States, Los Angeles |
30 octobre 1999 30 octobre 1999 |
452,6 245,4 |
basaltique shergottite |
|
Sayh al Uhaymir 005 Sayh al Uhaymir 008 Sayh al Uhaymir 051 Sayh al Uhaymir 094 Sayh al Uhaymir 060 Sayh al Uhaymir 090 |
Oman, Sayh al Uhaymir |
26 novembre 1999 26 novembre 1999 1er août 2000 8 février 2001 27 juin 2001 ?? |
1 344 8 579 436 233,3 42,28 94,84 |
basaltique shergottite |
|
Dhofar 019 |
Oman, Dhofar |
24 janvier 2000 |
1 056 |
basaltique shergottite |
|
GRV 9927 |
Antarctique, Grove Hill |
8 février 2000 |
9,97 |
péridotite (lherzolitic shergottite) |
|
Dhofar 378 |
Oman, Dhofar |
17 juin 2000 |
15 |
basaltique shergottite |
|
Northwest Africa 480 Théodore Monod |
Algérie ou Maroc |
Novembre 2000 |
28 |
basaltique shergottite |
|
Y000593 Y000749 |
Antarctique, Yamato Mountains |
29 novembre 2000 3 décembre 2000 |
13 700 1 300 |
clinopyroxenite (nakhlite) |
|
Northwest Africa 817 |
Maroc |
décembre 2000 |
104 |
clinopyroxenite (nakhlite) |
|
Northwest Africa 856 |
Maroc |
mars 2001 |
320 |
basaltique shergottite |
|
Northwest Africa 1068 Northwest Africa 1110 |
Maroc Maroc |
avril 2001 septembre 2001? |
654 118 |
basaltique shergottite |
|
NWA 998 |
Algérie ou Maroc |
September 2001 |
456 |
clinopyroxenite (nakhlite) |
|
NWA 1195 |
Maroc |
mars 2002 |
315 |
basaltique shergottite |
|
YA41075 |
Antarctique |
?? |
55 |
péridotite (lherzolitic shergottite) |
Le phénomène ALH84001
|
crédit photo : droits réservés |
crédit photo : droits réservés |
En août 1996, peu avant que le congrès américain décide des budgets à attribuer au domaine spatiale civil, une équipe scientifique du JSC (John Space Center) fait une annonce qui va relancer le thème de la recherche de la vie sur Mars : on aurait découvert une bactérie fossilisée dans une météorite martienne. Cette annonce a fait l'effet d'une bombe auprès du grand-public comme dans le monde scientifique. Après quelques années, cette météorite fait encore l'objet d'une attention particulière et des études lui sont régulièrement dévouées.
Mais pourquoi cette météorite est-elle annoncée comme porteuse d'une vie martienne ? Cette météorite est âgée de 4 milliards d'années et se serait mis en voyage dans l'espace à la faveur d'une météorite s'écrasant sur Mars. Puis, après un voyage de 3,5 milliards d'années, elle tombe sur Terre, plus précisemment en Antarctique. David S. McKay et son équipe l'ont étudiée et ont découverts différents indices allant en faveur d'une vie martienne.
I- Les microglobules de carbonates
Ces microglobules ont été découverts par une analyse au microscope éléctronique. Ce sont des bâtonnets longs de 20 à 150 nm ressemblant forts à des bactéries découvertes en Australie. Comme on peut le voir sur ces deux images, lorsuqe l'on compare ces bâtonnets à des bactéries terrestres, la ressemblance est frappante. D'ailleurs, des spécialistes s'y sont trompés lorsqu'on leur a présenté ces microglobules, avant que la découverte ne soit rendue publique (maintenant, tous les spécialistes connaissent les images et ne s'y trompent plus).
|
Les "bactéries" de la météorite crédit photo : droit réservés |
Une bactérie terrestre crédit photo : G. Lévèque |
Le seul problème que possèdent ces "bactéries", c'est leur petite taille. Des recherches concernant une formation chimique ont été effectués et une hypothèse à été échafaudé : ces bâtonnets se sont formés par l'altération chimique de l'argile. On reste donc sceptique sur la nature de ces microglobules. De plus, si ce sont des bactéries, rien ne s'oppose à ce qu'elles soient terrestres. On le voit, cette météorite n'a pas fini de faire parler d'elle.
II- Des molécules organiques
Des molécules de la famille de hydrocarbures polycycliques (on retrouve plusieurs "cercles" d'atomes de carbone liés les uns aux autres dans une même molécule) ont été retrouvées près des microglobules de carbonates. Ces hydrocarbures seraient les restes de ces microglobules après une décomposition. De plus, ils sont situés dans des failles assez profondes et reculées, rendant impossible ou très difficiles la venue de ces hydrocarbures par l'extérieur.
III-Des cristaux de magnétite
On peut retrouver des cristaux de magnétite dans ALH84001. Rien d'anormal là-dedans me diriez-vous. Eh bien si ! Certains de ces cristaux ont une structure si parfaite que la synthèse naturelle (c'est à dire sans intervenant extérieur) parait peut probable. Reste donc l'hypothèse d'une synthèse par une bactérie ou par un être vivant qui, comme tous les êtres vivants, donne une organisation artificielle à tout ce qu'il fabrique.
Tout ceci fait abstraction, en grande partie, de la thèse d'une contamination terrestre. En effet, si on peut prouver que ces traces proviennent bien d'une vie, rien ne prouve pour l'instant que cette vie provient bien de Mars. Des bactéries aussi petites sont très rares sur Terre, mais elles existent. C'est pourquoi il faut prendre ces annonces avec une certaine méfiance. La vie sur Mars ne doit pas être prise à la légère et toutes les autres hypothèses doivent être étudiées.